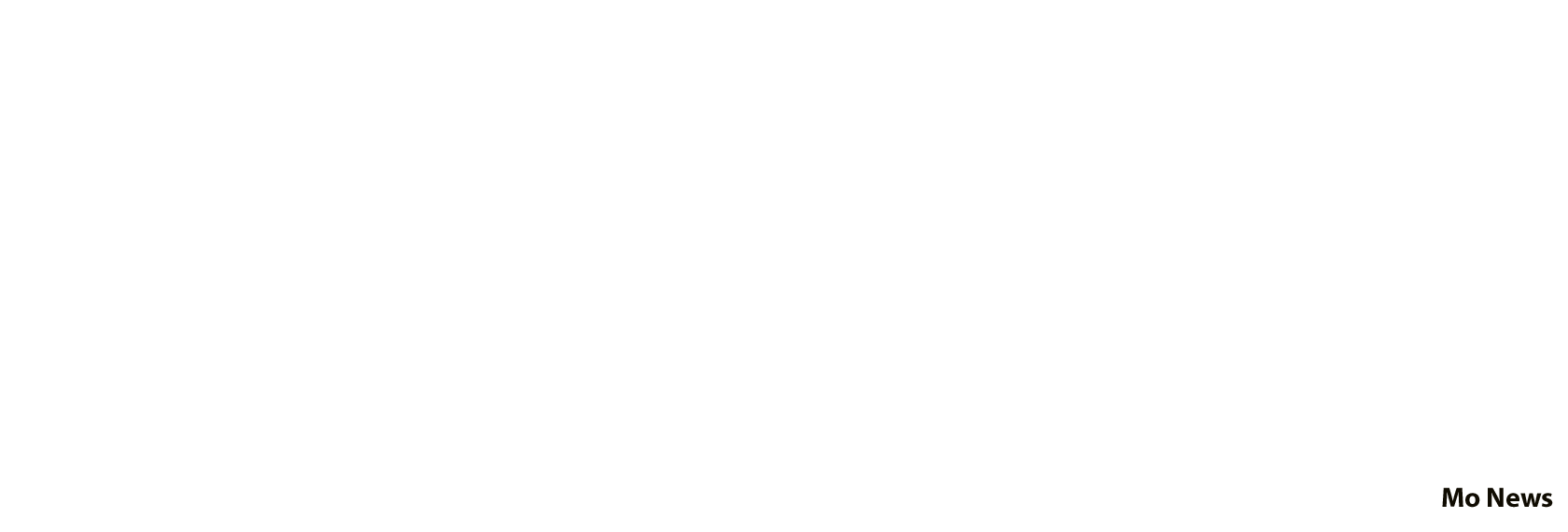À RETROUVER DANS L’HEBDO – Avec pertes et fracas, une partie des élus et citoyens du territoire ont blâmé « l’inertie » de l’État dans la prise en charge des demandeurs d’asile de la rue Arago. Dans les faits, quels sont réellement les solutions proposées aux migrants qui ont quitté leur pays dans des conditions dramatiques ? Revenons sur les bases d’un « modèle » qui fait l’objet de nombreuses dérogations et qui dispose de moyens limités…
En 2021, la Guyane et Mayotte ont recensé 87 % des demandes d’asile enregistrées au niveau national. Enclave française dans le continent sud-américain, la situation géographique de notre territoire entraîne des particularismes exacerbés par l’augmentation des demandes sur les 7 dernières années. Si le débat est centré depuis plusieurs mois sur les arrivées de demandeurs d’asiles en provenance de pays arabophones, le sujet doit être étudié sans aucun prisme politique.

Après une année 2020 où l’activité de l’administration s’était tarie en raison de la crise sanitaire, 2021 a marqué une augmentation de 12,9 % des demandes de protection. Dans son dernier rapport d’activité, l’Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA) chiffre avec précision les demandes d’asile en Guyane. Dans le détail, 3 174 demandes ont été enregistrées l’an passé. 2350 d’entre elles ont été rejetées, pour seulement 1080 acceptées. Ainsi, 31,5 % des demandes de protection ont reçu un avis favorable, soit un peu moins d’une demande sur trois.
Mais, plus globalement, quel est le parcours des demandeurs d’asile sur le territoire ? Comment les ressortissants sont-ils accompagnés (ou pas) à partir du passage de la frontière ?
LE PASSAGE DE LA FRONTIÈRE
Quel que soit le moyen de transport ou la méthode employée pour entrer sur le territoire, une personne qui manifeste sa demande d’asile n’est pas reconductible à la frontière, en vertu de la convention de 1951 (Convention de Genève) relative au statut des réfugiés. Avant le point d’entrée dans la procédure administrative, le premier contact des demandeurs d’asile avec l’administration française se fait par le biais de la police aux frontières (PAF) qui envoie alors un signalement à la préfecture. Dès lors, tout demandeur d’asile qui passe la frontière avec le Suriname ou le Brésil est orienté vers la Structure du premier Accueil des Demandeurs d’Asile (SPADA). Si, dans l’Hexagone, les SPADA sont gérées par une pluralité d’acteurs, aux Antilles-Guyane, par le biais d’un marché public, leur gestion est assurée par la Croix-Rouge française.
Une fois à la SPADA, le primo-arrivant est dirigé vers le Guichet Unique pour Demandeurs d’Asile (GUDA). Depuis plusieurs mois, ce guichet est saturé, faute de moyens suffisants alloués à son fonctionnement. En 2016 déjà, face à l’augmentation des demandes, la préfecture avait dû procéder à une fermeture en vue d’une restructuration, qui atteint à nouveau ses limites…
Les demandeurs d’asile, qui attendaient en général 48 h pour leur rendez-vous au guichet, patientent désormais plus longtemps. D’après les services de l’Etat, ce délai ne s’étire pas au-delà de 6,5 jours. Pendant ce laps de temps, les ressortissants ne relèvent pas du statut de demandeur d’asile, mais du droit commun. Seules des associations comme le Samu Social sont en droit de leur proposer un hébergement, une solution d’urgence pour les plus vulnérables.
QUELLES CONDITIONS MATÉRIELLES D’ACCUEIL ?
Pendant le rendez-vous au GUDA, le demandeur d’asile reçoit un livret spécifique pour la demande d’asile auprès de l’Office Français de Protection des Réfugiés Apatrides. Depuis un décret du 9 décembre 2019 visant à accélérer les procédures face à la recrudescence de requêtes, le délai imposé pour le dépôt du dossier auprès de l’OFRA est de 7 jours, contre 21 jours auparavant. Une mesure décriée par les organisations syndicales, notamment parce qu’elle enjoint les demandeurs à rendre leurs documents « en personne ». De surcroît, l’adaptation des modalités de traitement des demandes d’asile entraîne, selon les syndicats, des nuisances à la qualité de l’instruction.
Les conditions matérielles d’accueil proposées aux demandeurs pendant cet échange au GUDA dépendent quant à elles de la « nature » de la demande. Selon les services de l’Etat, en Guyane, il n’y a pas de différence de traitement entre un primo-demandeur et une personne qui a déjà fait sa demande d’asile dans un autre pays. De plus, la procédure dite « de Dublin », qui permet d’établir quel pays est responsable pour l’examen d’une demande d’asile, n’est pas applicable en Guyane.
Souvent l’objet de fantasmagories, l’aide matérielle et financière à laquelle peuvent prétendre les migrants, quand elle est octroyée, est dérisoire au regard du coût de la vie dans les DOM-TOM d’Amérique, qui concentrent 53 % des demandes d’asile à l’échelle nationale en 2021.
En arrivant sur le territoire français, les ressortissants étrangers qui déposent un dossier de demande d’asile ont droit à l’ADA (Allocation Demandeurs d’Asile). Ce coup de pouce financier varie, en fonction de la situation familiale du demandeur, de 6,80 euros/jour pour une personne seule (190 euros/mois) à 17 euros/jour pour un couple avec deux enfants (476 euros/mois). Une famille de 6 personnes recevrait environ 23,80 euros/jour (660 euros/mois). Un bien faible revenu, puisqu’il s’agit de la seule allocation financière que les demandeurs d’asiles peuvent percevoir. Sur le territoire national, les demandeurs n’ont pas le droit de travailler et donc d’obtenir un pécule supplémentaire.
IMBROGLIO AUTOUR DE L’HÉBERGEMENT
De longue date, les opérateurs chargés d’une mission de service public dans l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile réclament la délocalisation des centres de primo-accueil dans des communes plus proches des points d’entrée sur le territoire. Un débat remis « au goût du jour » avec la grève de la faim entamée par Sandra Trochimara, maire de Cayenne, qui réclamait des solutions dans un climat d’oppression générale autour de la rue Arago et de ses quelques demandeurs d’asile, pour la plupart arabophones.
Si la Croix-Rouge a longtemps opéré seule dans l’HUDA en Guyane (depuis 12 ans environ), l’association d’aide humanitaire devrait bientôt être ralliée par Vie Active, association retenue pour la mise en place d’un centre de premier accueil pérenne à Regina. Au total, sans compter les 16 lits proposés depuis peu au nouveau centre d’accueil temporaire de Cayenne (le site La Verdure) et ce projet de centre d’accueil à Regina, le territoire recense 727 places mises à disposition par l’Etat pour les demandeurs d’asile. Les opérateurs comme la Croix-Rouge interviennent uniquement sur l’hébergement d’urgence en cas de signalement de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII). En sus, des nuitées hôtelières sont parfois proposées aux demandeurs d’asile sur signalement. Ce dispositif porte à près d’un millier le nombre de places et représente à lui seul investissement d’environ 4 millions d’euros depuis le début de l’année 2022, selon les services de l’Etat.

Demandeurs d’asile sur la rue Arago, à Cayenne, en avril 2022.
Pour en revenir au contexte Cayennais : une fois passé par l’OFPRA, le demandeur d’asile peut retourner devant l’OFII pour rappeler sa volonté d’être hébergé. Raison pour laquelle les demandeurs d’asile de la rue Arago, pour la plupart des hommes seuls, se sont installés sur les trottoirs au centre de toutes les attentions. Ils réclament pour la plupart une prise en charge au sein d’un HUDA, structure dans laquelle ils peuvent prétendre à un accompagnement en vue, par exemple, de l’ouverture des droits à la sécurité sociale. Mais les places dans ce dispositif sont épisodiques. De plus, à ce jour, les services de l’État accordent la priorité aux personnes vulnérables.
En poursuivant un double objectif de rationalisation des dépenses publiques et de gestion des flux migratoires, l’action de l’État en Guyane pour la protection des réfugiés est ambigüe. Au vu du nombre de demandes d’asiles rejetées, les situations comme celle de la rue Arago, tristement exposée par le jeu politique, se multiplient dans les quartiers informels. « La population syrienne est minoritaire dans le nombre des demandeurs d’asile, mais majoritaire dans la demande d’hébergement. Il y a d’autres communautés qui ne font pas de demandes d’hébergement systématique », nous indique un observateur. Un appel à projet en vue de la pérennisation des 727 places en HUDA avait été lancé par la préfecture de Guyane en mai 2022. Il prévoyait notamment la création de 277 places supplémentaires. Selon nos informations, la fenêtre de dépôt des dossiers a dû être reportée en raison de l’absence de candidatures.